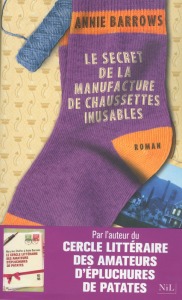Après les immenses succès qu’ont été La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le Livre des Baltimore, autant dire que La Disparition de Stephanie Mailer (Editions du Fallois) du même Joël Dicker, était plus qu’attendu. C’est sans doute la raison pour laquelle 300 000 exemplaires dudit roman ont été édités pour sa sortie annoncée en grandes pompes. J’avais personnellement adoré les deux premiers opus, c’est donc avec l’assurance de passer encore un très très agréable moment de lecture que je me suis précipitée sur La Disparition de Stephanie Mailer. Je ressors de cette lecture avec un avis mitigé, qui me vaut de classer aujourd’hui ce roman parmi mes déceptions. Peut-être tout simplement parce que j’en attendais trop…
Après les immenses succès qu’ont été La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le Livre des Baltimore, autant dire que La Disparition de Stephanie Mailer (Editions du Fallois) du même Joël Dicker, était plus qu’attendu. C’est sans doute la raison pour laquelle 300 000 exemplaires dudit roman ont été édités pour sa sortie annoncée en grandes pompes. J’avais personnellement adoré les deux premiers opus, c’est donc avec l’assurance de passer encore un très très agréable moment de lecture que je me suis précipitée sur La Disparition de Stephanie Mailer. Je ressors de cette lecture avec un avis mitigé, qui me vaut de classer aujourd’hui ce roman parmi mes déceptions. Peut-être tout simplement parce que j’en attendais trop…
Commençons par l’histoire : Le 30 juillet 1994, à Orphea, petite station balnéaire tranquille et plutôt huppée de la côte est des Etats-Unis, le maire de la ville, son épouse et leur fils sont sauvagement assassinés alors que s’ouvre la première édition d’un festival de théâtre. Une joggeuse, témoin des meurtres, figure également parmi les victimes. Deux jeunes enquêteurs, qui viennent de sortir de l’école de police, sont désignés pour mener l’enquête. Leur fougue leur permet de mettre un nom assez rapidement sur le coupable. Mais celui-ci meurt pendant son interpellation avant d’avoir pu avouer les crimes. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste, arrivée à Orphea depuis peu, affirme avec aplomb à l’un des deux inspecteurs qu’il s’est trompé de coupable à l’époque « parce qu’il n’a pas vu un détail qui se trouvait sous ses yeux ». Cette journaliste, c’est Stephanie Mailer. Le soir même, elle disparaît. Les deux inspecteurs, aidés par une jeune collègue venue à Orphea guérir une déception sentimentale, décident de reprendre l’enquête de zéro pour savoir ce qu’il est advenu de Stephanie Mailer et qui a bien pu commettre les quatre crimes 20 ans auparavant.
Le roman de Joël Dicker est construit comme une série américaine. Le lisant, j’ai souvent eu l’impression de me trouver dans « Cold Case », série dans laquelle Lily Rush et ses inspecteurs reprennent des affaires jamais élucidées à la faveur d’un nouvel élément. Comme dans la série, les inspecteurs découvrent des faits qui se sont passés à l’époque et les personnages les revivent à coups de flash-back écrits à la première personne. C’est aussi un roman où se croisent une multitude de personnages, qui, tous, cachent une fêlure qui ne nous est dévoilée que par petites touches. Une multitude de personnages qui permet de brouiller les pistes et de multiplier les suspects possibles. C’est sans doute là le réel talent de Joël Dicker : Parvenir à faire monter le suspens, à ajouter des fausses pistes aux fausses pistes et donc à nous rendre accros à la lecture. Parce que, dans ce domaine, le contrat est parfaitement rempli. J’ai dévoré les 635 pages de ce roman en quelques jours et ce fut un très agréable divertissement.
Alors, d’où me vient donc ce sentiment mitigé après avoir refermé ce livre hier soir ? Sans doute, d’abord, de ses personnages trop souvent caricaturaux et donc, improbables. Comment croire à cet ancien flic, reconverti en metteur en scène mégalomane et égocentré qui, depuis 20 ans, travaille la même première scène de sa pièce de théâtre, tout en injuriant et en renvoyant tour à tour ses comédiens amateurs, en survivant de petits boulots et en affirmant qu’il a écrit la pièce du siècle ? Comment croire à Alice, maîtresse vénale du rédacteur-en-chef d’un magazine littéraire new-yorkais qui surjoue l’hystérie et la bêtise intellectuelle ? Sans parler des « personnages clichés » : La riche épouse d’un directeur de chaîne de télévision qui n’en peut plus de cette vie trop facile et donc sans intérêt et qui rêve de retrouver le temps où elle et son mari tiraient le diable par la queue mais étaient heureux, au moins ! Ou encore la fille à papa trop gâtée et brillantissime au lycée qui tombe dans la drogue.
Sans doute aussi des incohérences dans le récit : Voilà deux enquêteurs qui, 20 ans plus tôt, ont bâclé une enquête en quelques semaines en oubliant d’interroger des témoins cruciaux et qui se révèlent tout compte fait, beaucoup plus intelligents et tatillons 20 ans après. Voilà aussi des témoins, qui, il y a 20 ans, savaient pertinemment que le coupable désigné n’était pas le bon parce qu’ils avaient la preuve que ça ne pouvait pas être lui. Mais qui n’ont rien dit à l’époque, en gros, parce qu’ils ne voulaient pas être emmerdés. Mais qui sont beaucoup plus loquaces 20 ans après. Voilà un coupable (le vrai) qui n’hésite pas à tuer trois personnes et à essayer d’en tuer une quatrième pour ne pas être découvert mais qui, à la toute fin du roman, avoue tout sans se faire prier et presqu’en pleurant, parce qu’on le menace de mettre une personne qui lui est chère en prison. Quel retournement ! Ca sent le final bâclé…
Sans doute enfin de quelques scènes ubuesques et complètement improbables comme la représentation de la pièce de théâtre qui frise le ridicule (non, qui est carrément ridicule et irréaliste) ou encore le chapitre sur les grands-parents de l’un des inspecteurs dont la vulgarité et la caricature m’ont mise vraiment mal à l’aise (Je me suis même demander si l’auteur n’avait pas volé ce chapitre à Nadine Monfils !). Sans parler encore une fois de l’improbabilité de la chose : Des gens vulgaires et bêtes à manger du foin qui se révèlent des gens exquis au contact d’une petite cousine charmante (qui tout compte fait n’est pas vraiment leur petite cousine d’ailleurs) venue s’installer chez eux et dont l’inspecteur tombe très vite amoureux (C’est pour éviter la consanguinité sans doute qu’il fallait qu’elle ne soit pas, tout compte fait, la petite cousine des grands-parents).
Joël Dicker a réussi à construire une énigme passionnante. Dommage, vraiment, qu’il l’est coulée dans un décor trop factice avec des personnages dépeints à la truelle et sans consistance.
 Les Mauvaises Graines, premier roman de l’Américaine Lindsay Hunter, paru en France chez Gallimard, ce sont Perry et Baby Girl, deux adolescentes lycéennes paumées qui vivent dans une petite ville américaine où l’avenir semble, plus qu’ailleurs, compromis par le chômage, la précarité et le déterminisme social. Perry, très jolie jeune fille provocante qui ne pense qu’à séduire et à coucher, vit avec sa mère, que l’ennui a rendue alcoolique, et son beau-père, un brave type, gardien de prison. Ils habitent tous les trois dans un mobil-home au sein d’un campement situé à la périphérie de la ville, au delà des quartiers résidentiels et des quartiers populaires. Baby Girl, elle, noie son manque de confiance en elle dans son surpoids et ses coiffures et tenues improbables, à la limite de la provocation. Elle vit avec son frère, ancien petit caïd de la drogue devenu handicapé mental suite à un accident qui lui a occasionné une grave blessure à la tête, aidée par un vague oncle, dont on ne sait pas trop quel est son rôle exact. Perry et Baby-girl fréquentent le même lycée mais on ne les voit que rarement en cours. Elles préfèrent zoner ou passer leurs nuits à voler des voitures, juste pour le plaisir de voir l’adrénaline monter, et multiplier les conneries. C’est dans ce contexte qu’elles font la connaissance de Jamey via les réseaux sociaux, un Jamey qui devient de plus en plus insistant, de plus en plus présent, de plus en plus envahissant. Un Jamey dont elles ne savent rien mais qu’elles acceptent pourtant de rencontrer. Pour mieux s’en débarrasser, croient-elle.
Les Mauvaises Graines, premier roman de l’Américaine Lindsay Hunter, paru en France chez Gallimard, ce sont Perry et Baby Girl, deux adolescentes lycéennes paumées qui vivent dans une petite ville américaine où l’avenir semble, plus qu’ailleurs, compromis par le chômage, la précarité et le déterminisme social. Perry, très jolie jeune fille provocante qui ne pense qu’à séduire et à coucher, vit avec sa mère, que l’ennui a rendue alcoolique, et son beau-père, un brave type, gardien de prison. Ils habitent tous les trois dans un mobil-home au sein d’un campement situé à la périphérie de la ville, au delà des quartiers résidentiels et des quartiers populaires. Baby Girl, elle, noie son manque de confiance en elle dans son surpoids et ses coiffures et tenues improbables, à la limite de la provocation. Elle vit avec son frère, ancien petit caïd de la drogue devenu handicapé mental suite à un accident qui lui a occasionné une grave blessure à la tête, aidée par un vague oncle, dont on ne sait pas trop quel est son rôle exact. Perry et Baby-girl fréquentent le même lycée mais on ne les voit que rarement en cours. Elles préfèrent zoner ou passer leurs nuits à voler des voitures, juste pour le plaisir de voir l’adrénaline monter, et multiplier les conneries. C’est dans ce contexte qu’elles font la connaissance de Jamey via les réseaux sociaux, un Jamey qui devient de plus en plus insistant, de plus en plus présent, de plus en plus envahissant. Un Jamey dont elles ne savent rien mais qu’elles acceptent pourtant de rencontrer. Pour mieux s’en débarrasser, croient-elle. C’est au gré de mes déambulations à la médiathèque de ma ville que j’ai découvert Catherine Cusset. J’en avais vaguement déjà entendu parler et c’est parce que « son nom me disait quelque chose » que j’ai eu envie de feuilleter L’autre qu’on adorait paru il y a quelques années chez Gallimard. Le thème abordé, le suicide d’un proche, m’a touchée. J’ai donc emprunté le roman.
C’est au gré de mes déambulations à la médiathèque de ma ville que j’ai découvert Catherine Cusset. J’en avais vaguement déjà entendu parler et c’est parce que « son nom me disait quelque chose » que j’ai eu envie de feuilleter L’autre qu’on adorait paru il y a quelques années chez Gallimard. Le thème abordé, le suicide d’un proche, m’a touchée. J’ai donc emprunté le roman. Je viens de terminer La nuit des Corbeaux (édition Presses de la Cité), un thriller de John Connolly, auteur que je connaissais de nom mais que je n’avais encore jamais lu. Après en avoir fini avec un roman qui m’avait laissée sur ma faim, je souhaitais me plonger dans un livre haletant dont j’aurais eu du mal à lâcher la lecture. Les thrillers de John Connolly, unanimement salués par la critique, me paraissaient être ce qui convenait le plus à mon humeur du moment. J’ai donc pioché, un peu au hasard dans le rayon très fourni des « John Connolly » d’une librairie, La nuit des Corbeaux.
Je viens de terminer La nuit des Corbeaux (édition Presses de la Cité), un thriller de John Connolly, auteur que je connaissais de nom mais que je n’avais encore jamais lu. Après en avoir fini avec un roman qui m’avait laissée sur ma faim, je souhaitais me plonger dans un livre haletant dont j’aurais eu du mal à lâcher la lecture. Les thrillers de John Connolly, unanimement salués par la critique, me paraissaient être ce qui convenait le plus à mon humeur du moment. J’ai donc pioché, un peu au hasard dans le rayon très fourni des « John Connolly » d’une librairie, La nuit des Corbeaux.  De Bernard Minier, je ne connaissais que le nom que j’entends à la radio à chaque sortie de l’un de ses romans. Au ton employé par la personne chargée d’en faire la publicité, j’avais compris qu’il était auteur de thrillers et qu’il était l’un des romanciers français à vendre le plus dans l’hexagone. Et puis, cet été, en vacances dans la famille, j’ai vu l’une de mes cousines complètement happée par la lecture d’un roman de Bernard Minier. Il s’avère que mes dernières lectures ne m’avaient pas vraiment emballée, j’avais vraiment envie de retrouver cette sensation incomparable d’être prise par la lecture d’un livre jusqu’à avoir du mal à le poser 5 minutes.
De Bernard Minier, je ne connaissais que le nom que j’entends à la radio à chaque sortie de l’un de ses romans. Au ton employé par la personne chargée d’en faire la publicité, j’avais compris qu’il était auteur de thrillers et qu’il était l’un des romanciers français à vendre le plus dans l’hexagone. Et puis, cet été, en vacances dans la famille, j’ai vu l’une de mes cousines complètement happée par la lecture d’un roman de Bernard Minier. Il s’avère que mes dernières lectures ne m’avaient pas vraiment emballée, j’avais vraiment envie de retrouver cette sensation incomparable d’être prise par la lecture d’un livre jusqu’à avoir du mal à le poser 5 minutes. Après les immenses succès qu’ont été La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le Livre des Baltimore, autant dire que La Disparition de Stephanie Mailer (Editions du Fallois) du même Joël Dicker, était plus qu’attendu. C’est sans doute la raison pour laquelle 300 000 exemplaires dudit roman ont été édités pour sa sortie annoncée en grandes pompes. J’avais personnellement adoré les deux premiers opus, c’est donc avec l’assurance de passer encore un très très agréable moment de lecture que je me suis précipitée sur La Disparition de Stephanie Mailer. Je ressors de cette lecture avec un avis mitigé, qui me vaut de classer aujourd’hui ce roman parmi mes déceptions. Peut-être tout simplement parce que j’en attendais trop…
Après les immenses succès qu’ont été La vérité sur l’affaire Harry Quebert et Le Livre des Baltimore, autant dire que La Disparition de Stephanie Mailer (Editions du Fallois) du même Joël Dicker, était plus qu’attendu. C’est sans doute la raison pour laquelle 300 000 exemplaires dudit roman ont été édités pour sa sortie annoncée en grandes pompes. J’avais personnellement adoré les deux premiers opus, c’est donc avec l’assurance de passer encore un très très agréable moment de lecture que je me suis précipitée sur La Disparition de Stephanie Mailer. Je ressors de cette lecture avec un avis mitigé, qui me vaut de classer aujourd’hui ce roman parmi mes déceptions. Peut-être tout simplement parce que j’en attendais trop…